Bilan culturel 2020
Publié le 2 janvier 2021 dans les catégoriesbilanblog
Films: 47 sur 45, soit 104.44% de l’objectif initial.
Jeux vidéo: 79 sur 36, soit 219.44%
Livres: 6 sur 20, soit 30%
BDs: 75 sur 24, soit 312.50%
Albums: 41 sur 24, soit 170.83%
Côté cinéma, j’ai tout juste fait l’objectif. J’ai repris goût à Mubi, notamment grâce à la mise en place d’un système de visionnage en simultané avec un ami, qui m’a motivé pour découvrir environ la moitié des films sur l’année. Je ne me vois pas en regarder plus que ça par an, ce rythme me convient.
Côté jeux vidéo, ça va toujours. Beaucoup de titres que j’ai fait cette année sortaient de mes backlogs sur les différentes plateformes, et c’est plutôt chouette. Certes, je crois qu’ils se sont plus remplis que vidés dans l’absolu, mais le mouvement y est. Il faut la cadence maintenant. J’ai également fait des périodes avec des thèmes précis, par exemple un bloc horreur/tension autour d’Halloween, un petit bloc FPS à un autre moment de l’année, etc. Bien souvent ces blocs sont streamés sur ma chaîne twitch, ça permet aussi de partager quelques bons ou mauvais moments vidéoludiques. C’est un comportement que je continuerai de faire cette année.
Côté livres, l’inspiration n’était pas au rendez-vous, même si c’est tout de même deux livres de plus que l’année dernière. Après un début d’année très durassien, tant littéraire que cinématographique, Marie Ndiaye m’a achevé, et j’ai bien failli ne pas en relever pour le semestre restant. J’ai préféré prendre des BDs, ça se lit plus vite, il y a des jolies images et moins de subjonctif et de virgules, vous comprenez.
Côté albums de musique, aucun souci. Des bonnes découvertes, moins d’albums oubliés aussitôt écoutés. Quelques ratés aussi. Si vous me trouviez péniblen en jeux vidéo, sachez qu’en musique c’est pire.
Côté bandes dessinées, on sent que le confinement et la bibliothèque ont fait bon ménage. J’ai fini quelques séries d’une traite ou presque, d’autres sont en cours. J’aimerais bien emprunter et lire de la bande dessinée occidentale aussi, ça fait longtemps que je n’en ai pas ouvert, et les Tintin commencent à remonter loin dans les années collège.
Commentaires sur les oeuvres et recommandations
Comme d’habitude, je liste toutes les oeuvres (re)découvertes, en laissant parfois un commentaire sur certaines d’entre elles. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur une oeuvre non-commentée, envoyez-moi un message via les canaux habituels et je mettrai à jour ce billet de blog en rajoutant un paragraphe sur l’oeuvre choisie. À nouveau, en vert je les recommande, en rouge non.
Films
L’année dernière à Marienbad (Alain Resnais, 1961): Une économie des mots pour un faste de classe, l’ennui du jeu de cartes, le jeu amoureux de l’ennui, l’amour joueur écartelé.
Don’t Look Now (Nicolas Roeg, 1973): non, vaut mieux pas regarder en effet.
2001 : A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968): alors le visionnage n’a pas eu lieu à 20h01, effectivement, mais l’avantage d’enchaîner deux ans avec des 2, des 0 et des 1 dedans, c’est qu’on pourra recommencer à faire une association de chiffres dès l’année prochaine.
Mon Oncle (Jacques Tati, 1958)
Manhunter (Michael Mann, 1986)
Porco Rosso (Hayao Miyazaki, 1992)
My Neighbor Totoro (Hayao Miyazaki, 1988): on avait commencé une rétrospective Ghibli avec ma compagne, mais ces deux-là nous ont un peu refroidi. C’est une chose de se lamenter que beaucoup de gens dans l’industrie de l’animation n’observe pas suffisamment l’humanité, ce qui amène à créer des productions où il y en a soit pas beaucoup, soit trop de caricatures et de projections. C’est vrai; c’en est une autre de verser dans le wakon yōsai détaché et le romantisme naïf, pour finalement se retrouver avec une humanité teintée de rose, où les problèmes se résolvent avec un peu de chance, de la volonté et un chat-bus qui tourne à l’eau cristalline sur une ligne de transport rural qui ne connaît pas la crise, grand bien lui fasse.
The Trial (Orson Welles, 1962): une interprétation du livre de Kafka qui met l’accent sur la désorientation et le vertige presque physique qui peut saisir les individus face au collectif, l’être nommé contre la chose innommable, innombrable, mais pourtant humaine, trop humaine. Comment expliquer alors cette fin, je ne comprends pas. Ça fait sacrément tâche.
Scott Pilgrim vs the World (Edgar Wright, 2010)
Murder! (Alfred Hithcock, 1930): Le Douze hommes en colère du pauvre, avec un juré qui s’éprend de l’accusée, qui plus est, pour une romance complètement dispensable.
Aguirre, la colère de Dieu (Werner Herzog, 1972)
Muriel ou le temps d’un retour (Alain Resnais, 1963)
Le Corbeau (Henri-Georges Clouzot, 1943): un whodunnit à la française, avec des dialogues savoureux, tour à tour acerbes, narquois, désopilants. Une galerie de personnages aux couleurs aussi hautes que leurs intentions sont basses.
Mon oncle d’Amérique (Alain Resnais, 1980)
Bajirao Mastani (Sanjay Leela Bhansali, 2015)
India Song (Marguerite Duras, 1975): un peu l’impression de voir un film fanservice de Duras pour les gens qui aiment Duras. Je marche à fond dedans. Si ce n’est pas pour elle, regardez au moins pour le morceau de bossa nova qui se lance tout à coup en fond sonore pendant qu’un type hurle à plein poumons son chagrin d’amour alors qu’il déambule dans un château français où les lustres sont bien haut. Un moment absolument incroyable, du shitpost des années 70, de l’or pour les oreilles. L’exercice sera répété et paufiné dans Baxter, qui vient après.
La Vie est un roman (Alain Resnais, 1983)
Tropical Malady (Apichatpong Weerasethakul, 2004): non, décidément, le cinéma de l’Asie du sud-est, ça ne passe pas. J’essaie, je vous assure, je fais de mon mieux, mais c’est un ennui absolu.
Ghost in the Shell 2 : Innocence (Mamoru Oshii, 2004): regardez Angel’s Egg plutôt.
Near Dark (Kathyn Bigelow, 1987): moui, d’accord. Bishop en vampire, c’est rigolo.
Les lieux de Marguerite Duras (Michelle Porte, 1976): 2020 a été une année très durassienne, à l’évidence.
Big Fish & Begonia (Liang Xuan, Zhang Chun, 2016): il y a du travail là-dedans, mais ça manque de liant. La narration effilochée et le manque de profondeur dans les personnages peinent à élever des tableaux au demeurant enchanteurs.
Fullmetal Alchemist (Fumihiko Sori, 2017): j’ai mal à mon adolescence. Ça aurait eu sa place en direct-to-dvd sur un stand de la Japan Expo avec l’équipe des cosplayers à côté pour signer des autographes d’une main tout en tenant la perruque blonde de l’autre.
Annihilation (Alex Garland, 2018): on peut dire beaucoup de choses sur le film, mais ce que j’en retiens le plus c’est la désintégration et la mutation pogressive de la musique, qui, comme le reste de l’oeuvre, finit par devenir autre chose, quelque chose qui n’est plus de la musique, et en même temps c’est toujours de la musique, à un niveau plus fondamental, en mutation, incohérente, atonale, ou complètement tonale, avec toutes les harmonies jouées d’un coup et comprimant le temps et l’espace dans la partition. Une fusion et une défusion, des notes et des non-notes, un jeu de miroir qui reflète les sons, les personnages, les lieux, l’alien qui imite Nathalie Portman dans le climax.
La Famille indienne (Karan Johar, 2001): une bonne source de stickers, et une YTP savoureuse.

Margin Call (J.C Chandor, 2011)
The Big Short (Adam McKay, 2015): deux films sur la finance, le temps de deux soirées avec ma compagne. C’est intéressant de les mettre en parallèle pour voir les aspérités qui se dessinent au creux des courbes et des bulles de spéculation. Quand l’un cherche à étouffer la catastrophe par obfuscation et anonymisation de la faute devenu artificielle, à l’instar des ordinateurs qui contrôlent le marché à la nanoseconde près, l’autre décide de retrouver l’humain derrière et les dialogues simples, évidents, qui cimentent les failles inhérentes aux schémas vendus sur le pas de la porte des maisons déjà hypothéquées. Quand l’un se passe en huis clos, ambiance costard cravatte et néon bleu à quatre heures du matin, l’autre s’expose au grand jour et aux agences en espace ouvert, et ses personnages avec. Et au milieu de tout ça, la parole mensongière, l’hyperréalité de l’économie, la gouvernance par les nombres.
Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures (Apichatpong Weerasethakul, 2010)
Junun (Paul Thomas Anderson, 2015): finalement, je préfère écouter des pistes de l’album de temps en temps plutôt que de repenser au documentaire.
A Portuguesa (Rita Azevedo Gomes, 2018): c’est beau comme un tableau du 17ème; hélas, je n’aime pas le figuratif.
Landless (Camila Freitas, 2019)
Kind Hearts and Coronets (Robert Hamer, 1949): pas aussi acide que je l’aurais souhaité, mais ça reste divertissant. Je n’oublierai pas les scènes finales de sitôt, très amusantes.
Still Walking (Hirokazu Kore-eda, 2008): quel intérêt de voir à l’écran une famille dysfonctionnelle quand on a eu la chance de l’avoir expérimentée 20 ans, hmm? Je vous le demande.
La Forteresse (Fernand Melgar, 2008): il y a des moments absolument incroyables, au sens premier. Lorsque le directeur du centre d’accueil des demandeurs et demandeuses d’asile annule un rendez-vous qu’on devine important, pour se joindre à une prière collective qui transpire d’effervescence et de transcendance — une prière qui lui est detinée qui plus est, parce que les gens dans le centre l’estiment et le respectent pour ce qu’il essaie de faire pour eux, contre le système en place, au point de vouloir le bénir et l’intégrer dans leur rites, dans leur religion, pour tout lier à nouveau ensemble — et que la caméra capture son regard au milieu du groupe en furie, à nouveau au sens premier, c’est impossible de déceler ce qu’il croit à ce moment-là. La croyance est superflue, seules restent les actions, celle du quotidien, pour se battre, encore et encore, avec ou sans Dieu, et surtout sans.
Lethal Weapon 2 (Richard Donner, 1989): des films comme ça on n’en fait plus. Ah c’est sûr, par les temps qui courent, l’apologie de la force policière, ça passe forcément moins bien…
Vol Spécial (Fernand Melgar, 2011): relire Hannah Arendt, en particulier Eichmann à Jérusalem.
L’abri (Fernand Melgar, 2014): à noter que les trois films de Fernand Melgar, et tous ses autres, sont disponibles intégralement sur sa chaîne Youtube, le réalisateur étant un grand défenseur du mouvement copyleft.
Sans Soleil (Chris Marker, 1983): si j’avais su que j’aurais pu faire carrière dans le cinéma documentaire en gardant mes copies de commentaire composée du lycée…!
The Tree House (Minh Quy Trupong, 2019): ça ne passe toujours pas. J’y arriverai un jour. Un jour.
Uzak [Lointain] (Nuri Bilge Ceylan, 2002)
Üç maymun [Les Trois Singes] (Nuri Bilge Ceylan, 2008): du très bon théâtre.
Katalin Varga (Peter Strickland, 2009): une figure puissante, radicale, deleuzienne, passionnée et passionnante, réduite à néant par une fin conservatrice au possible. Si je trouve l’occasion, j’essaierai d’écrire dessus.
Nimic (Yorgos Lanthimos, 2019)
Black Coal, Thin Ice (Diao Yi’nan, 2014)
Hypernormalisation (Adam Curtis, 2016): c’est un collage qui raconte plus que la somme des bouts singuliers qui le composent — et malheur à qui le prendrait dans l’autre sens; c’est un labyrinthe postmoderne, l’antichambre d’une recherche sans boussole, l’impulsion pour se propulser vers la lisière de sa bulle de confort; c’est une oeuvre taillée pour l’ère du numérique, profitant des possibilités de pouvoir revenir en arrière, accélérer, passer des morceaux, garder ce qu’on aime et jeter ce qu’on aime pas d’un revers de la main, sans autre considération. C’est un pouvoir vertigineux, et c’est un piège d’orgueil.
Baxter, Véra Baxter (Marguerite Duras, 1977): le shitpost est parfait de bout en bout. Marguerite, tu nous régales !
Nostalgia de la Luz (Patricio Guzman, 2010): Chris Marker a trouvé son prétendant, attention la bataille sera terrible. A coups de métaphores tirées par les cheveux et de parallèles au mieux naïfs, au pire inappropriés et indécents, les deux vont essayer de relier Pac-Man au calcium des étoiles à neutrons en passant par l’Egypte et les pyramides. Savent-ils au moins placer le pays sur la carte sans passer par la case “de tout temps” ? Come on.
Jeux vidéo
Magicka (Arrowhead Game Studios, Paradox Interactive, 2011)
Monaco : What’s Yours is Mine (Pocketwatch Games, 2013)
Castle Crashers (The Behemoth, 2008)
The Crew (Ivory Tower, Ubisoft Reflections, Ubisoft, 2014): Malgré et en dépit de l’écosystème Ubisoft qui se met en travers de toute tentative d’expérimenter le monde proposé dans son ensemble, sans micro-quêtes et autres coupures de jeu pour ludifier à excès ce qui reste essentiellement un road trip contemporain, il s’avère néanmoins que ce monde est là, avec ses distances qu’on se sent parcourir sans raccourci — ou presque, le voyage rapide fait partie de ses coupures mentionnées ci-dessus et que je regrette — son envergure, son hétéroclisme géographique, son histoire discrète dans l’urbanisme — ou son absence.
Night of the Full Moon (Giant Network, 2019)
The Witness (Thekla, Inc., 2016): au commencement était le verbe.
2000:1 A Space Felony (National Insecurities, 2017)
Brownie Cove Cancelled (Sand Gardeners, 2018)
Exhaustlands (Sand Gardeners, 2018)
Pilgrimage (La Dispute, 2019): pire que le jeu-musée, l’animation interactive.
No Players Online (papercookies, 2019)
Kingdom Hearts (Square, 2002)
Elora’s Raid (Eyou games, 2019)
Space Captain McCallery – Episode1 : Crash Landing (Tales of the Renegade Sector, 2018)
WitchWay (Andrew Gleeson, 2017)
Shu’s Garden (Colin Sanders, Jason RT Bond, 2015)
No Response (Yarn Spinner, 2018)
Milkmaid of the Milky Way (Mattis Folkestad, 2018)
Spyro 2 : Ripto’s Rage (Insomniac Games, SCE, 1999)
Demon’s Souls (FromSoftware, SCE, 2009): ce monde a eu une infinité de fois le temps d’exister, de tomber, et de recommencer, avant qu’on y débarque; après notre passage, il aura une infinité de fois le temps d’effacer les traces de ce voyage, à la fois intradiégétiquement, mécaniquement, narrativement, métatextuellement. Entre-temps, il est. Pour toi? Momentanément. Contre toi? Possiblement. En toi? Essentiellement.
Hob (Runic Games, 2017): la forme la plus excitante d’exploration environnementale qu’il m’ait été donné de faire cette année. Le monde comme terrain de jeu, mécanique, organique, avec des imbrications sur différentes échelles de perception, intégrées à même le relief.
A Short Hike (Adam Robinson-Yu, 2019): la forme la plus candide d’exploration environnementale qu’il m’ait été donné de faire cette année.
Hyper Light Drifter (Heart Machine, 2016): l’indifférence du temps passé et de l’univers d’HLD souffre de la comparaison avec ses inspirations directes (les Souls et Zelda 1, principalement).
GNOG (KO_OP, Double Fine Presents, 2018): le jouet-jeu, le plaisir simple de manipuler du volume numérique. Le cube en bois de 20XX.
Stories Untold (No Code, Devolver Digital, 2017): l’équivalent des histoires racontées au coin du feu avec des effets spéciaux bricolées maison, pour renforcer l’ambiance. Je regrette l’entêtement à essayer de rattacher ça à une narration qui fait sens, avec une histoire d’accidents, de regrets, etc. Les sentiments évoqués suffisaient, l’univers se moque de la cohérence.
Mutazione (Die Gute Fabrik, Akupara Games, 2019): sans même parler de la pénibilité mécanique dans l’oeuvre, où marcher d’un bout à l’autre de la carte vient se mettre en travers du dialogue qui est le seul élément de valeur, c’est trop verbeux pour son propre bien, trop attaché à la potentialité dramatique et en même temps pas suffisamment pour en faire quoi que ce soit de radical. C’est un jeu inoffensif, qui explore timidement des thèmes sans jamais aller jusqu’au bout, et qui revient vers la sécurité des bons sentiments. La fin qui semble promouvoir la recherche de l’équilibre et une forme de retour à la nature est l’ultime affront. Laissez la nature, peu importe ce que ça peut bien vouloir dire, en dehors du drame inhérent aux relations humaines. Embrassez le théâtre, ne le masquez pas derrière la prétension d’une naturalité équilibrée, dans un univers fondamentalement entropique. Quelle mauvaise blague.
Battlefield 3 (DICE, EA, 2011): début du bloc FPS, on commence fort.
SUPERHOT (Superhot Team, 2016): le méta a encore frappé.
Metro 2033 (4A Games, THQ, 2010): un univers tangible, avec une société dépeinte comme débrouillarde, bricoleuse, survivante. Le souci du détail dans sa représentation renforce l’immersion. Cela passe par la tension constante entre la sécurité relative des avant-postes dans les égouts et le froid mordant de l’extérieur, où chaque excursion est chronométrée non pas via une interface de jeu vidéo, mais par un outil intradiégétique — une boussole, un masque à gaz qui se fissure, une jauge de pression sur la lampe à gaz propane.
L’album secret de l’oncle Ernest (Lexis Numérique, Emme Interactive, 1998)
Le Fabuleux Voyage de l’Oncle Ernest (Lexis Numérique, Emme Interactive, 1999)
Forestia (Daddyoak, Lasermedia, 1998): petit bloc de jeux de l’enfance, en l’occurrence ceux de ma compagne. Les deux Oncle Ernest étaient amusants; Forestia a quelques moments forts. Enfin, c’est rigolo et légèrement caustique de constater qu’un jeu éducatif de 1998 parvient plus à convaincre de l’intérêt de son mode photo que l’ensemble des jeux qui ont introduit cet outil par la suite.
Hair Nah (momopixel, 2017)
Downfall Redux (Harvester Games, Screen 7, 2016)
Downfall (Harvester Games, Screen 7, 2009): il y aurait matière à écrire sur une comparaison des deux versions du jeu, dans la différence graphique, mais aussi les changements de certains détails de narration et d’histoire. Je préfère cette version, la première, son univers est plus authentique. Celui de 2016 est hanté par The Cat Lady.
Edge (Mobigame, 2008)
Mu Cartographer (Titouan Millet, 2016): la carte et le territoire, voir les billets de Yudkowsy à ce sujet.
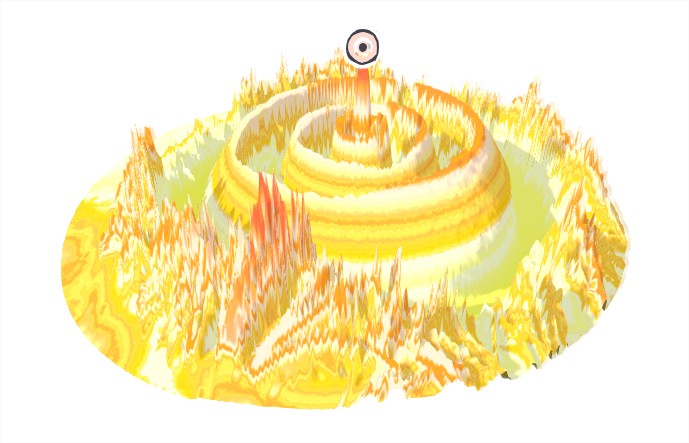
RiME (Tequila Works, Grey Box, Six Foot, 2017): le jour où on arrêtera de véhiculer la théorie — malcomprise qui plus est — d’Elizabeth Kübler-Ross, on aura fait un grand pas.
Abzû (Giant Squid Studios, 505 Games, 2016): le jeu-musée mort, inerte, conservé, ici le musée océanographique de Monaco.
Close to the Sun (Storm in a Teacup, Wired Productions, 2019): un Bioshock du pauvre, sans philosophie, sans puzzles dans les combats, sans ambiance.
Artus contre le démon du musée (Gyoza Média, Hachette Multimédia, 2000)
Never Alone [Kisima Inŋitchuŋa] (Upper One Games, E-Line Media, 2014): si vous voulez faire parler une culture et une ethnie, alors laissez-les parler. Ne la saupoudrez pas par-dessus un médiocre jeu de plateformes Unity façon ingrédients exotiques et folklore pour occidentaux en manque d’anecdotes pour briller en soirée sur leur ouverture cosmopolite.
Tales of Crestoria (Bandai Namco, 2020): la série Tales à la sauce gacha, ça ne prend pas. L’impression de voir une série s’auto-cannibaliser à force de faire des cross-overs avec elle-même.
Hollow Knight (Team Cherry, 2017): j’en ai déjà beaucoup trop parlé à l’oral. En résumé, c’est trop sophistiqué pour moi. Tout se veut beau, tout est naïf, tout est violon et piano, tout se veut poétique, élégant, tout est léché, rien n’est brut, tout est inspiré, rien n’est aspirant à faire quoi que ce soit de neuf. C’est aussi personnel et authentique que peut l’être une copie de copies de suites de genres de jeux, autant dire nullement.
Guacamelee ! (DrinkBox Studios, 2013): tout seul, je l’aurais abandonné au bout de deux heures.
Symphonia (ISART Digital, 2020)
Aaaarrrrgggghhhh (GOPPA, 2020)
That Feeling Blue (colorfiction, 2020)
The Year After (Hadrian Lin, 2020): essaie encore, peut-être qu’un jour Critical Distance remarquera ton oeuvre about.
A Mortician’s Tale (Laundry Bear Games, 2017): le jeu me parle comme à un enfant qu’il faudrait éduquer, non pire, réveiller.
Genshin Impact (miHoYo, 2020)
AER Memories of Old (Forgotten Key, Daedalic Entertainment, 2017): complètement oubliable, un énième platformer environnemental 3D poétique sous Unity.
Pikuniku (Sectordub, Devolver Digital, 2019): des bons passages amusants.
Dream Daddy : A Dad Dating Simulator (Game Grumps, 2017): l’écriture est trop américano-américaine, et les relations trop peu approfondies. On sent que c’est troisième degré, et en même temps pas tant que ça.
Heroes of Sokoban (Jonah Ostroff, 2013)
0_abyssalSomewhere (nonoise, 2018): du grand potentiel d’univers mort-né, dans la lignée de Demon’s Souls et Shadow of the Colossus.
Stone House Orphanage (pixelb, 2020)
Layers of Fear 2 (Bloober Team, Gun Media, 2019): c’est comme le premier, mais en pire. Je ne pensais pas cela possible, mais si si: non content de reprendre la formule de tour guidée dans une exposition de l’horreur millimétrée et calibrée qui était déjà dans le premier opus, celui-là rajoute par-dessus des séquences de poursuite sans liberté, sans tension de l’échec. Où est l’intérêt ?
The House in the Woods (Minigoliath, 2020)
Water Womb World (Yames, 2020): intrigant, claustrophobique, eschatologique ?
FAITH (Airdorf, 2017): l’ambiance minimaliste, notamment au niveau du son, renforce l’anxiété ambiante.
Dear Substance of Kin (Deconstructeam, 2019): l’écriture et l’univers mériteraient un jeu plus long.
They Came First (Jordan Taylor, Jack Connor, 2020)
>Observer (Blooper Team, Aspyr, 2017): il y a des choses à dire sur ce jeu. C’est, rétrospectivement, le moins mauvais du studio.
Amnesia : A Machine for Pigs (The Chinese Room, Frictional Games, 2013): un ennui profond. Je n’appréciais déjà pas beaucoup Amnesia premier du nom, mais celui-là semble avoir encore moins compris ce qui a pu marcher pour d’autre personnes dans son prédécesseur, un comble.
Soul Void (Kadabura, 2019): un pixel art raffiné.
Vertigo Temple (psy_wombats, 2020)
Ridgewood Road (Milkbar Lads, 2020)
SOMA (Frictional Games, 2015)
Blair Witch (Bloober Team, Lionsgate Games, 2019); un jeu malhonnête, paresseux, et voleur de concepts et d’univers qu’il ne comprend pas.
Lorelai (Harvester Games, Screen 7, 2019): le plus faible de la série. Passé l’introduction et les deux premiers chapitres, le jeu tombe dans une formule qui peine à exprimer quoi que ce soit. Les antagonistes sont agaçants plus qu’inquiétants, la personnalité de Lorelai est passe-partout (et parfois bitchy à l’excès ?), et les environnements — ainsi que les métaphores à travers eux — consensuels.
novena (Cécile Richard, 2018)
Don’t Starve Together (Klei Entertainment, 505 Games, 2016): finalement le jeu demande de ne pas le jouer comme il le faudrait, et de le monter à notre façon, en enlevant tel ou tel élément, en accélérant pour arriver à telle ou telle saison, parce que l’action de l’instantanté au jour le jour transmet quasiment rien, surtout au bout de la trentième fois.
Dark Souls (Bandai Namco, From Software, 2011)
NaissanceE (Limasse Five, 2014): j’ai un réel problème avec ce jeu, et vous en saurez plus bientôt, et en le couchant par écrit, cela parlera plus de moi que du jeu. Cela en fait un bon jeu, mais ça n’en fait pas pour autant un bon jeu. Vous suivez ?
bernband (Tom van den Boogaart, 2014): bernband est en opposition directe avec NaissancE.
hernhand (Jake Clover, 2015): hernhand est en ligne directe avec bernband. Ça suit toujours ? Bien.
The Search (Jason Godbey, 2017): très embarrassant.
Fragments of Euclid (NuSan, 2017)
Livres
Un barrage contre le Pacifique (Marguerite Duras, 1950)
Le marin de Gibraltar (Marguerite Duras, 1952)
Le dieu du carnage (Yasmina Reza, 2008)
La Nausée (Jean-Paul Sartre, 1983): la pièce manquante du puzzle, l’alpha et l’oméga de la pensée sartrienne.
Trois femmes puissantes (Marie Ndiaye, 2009): ce livre m’a laissé coi. Je n’ai pas pu le finir, l’écriture m’a mis par terre par sa lourdeur, sa sophistication inexpliquée, qui tend vers l’exercice de style intéressé à raffler des prix. Ce n’est pas un hasard si on lui a décerné le prix Goncourt cette année. Plus jamais ça.
Le degré zéro de l’écriture (Roland Barthes, 1953): lu en préparation de quelques textes à venir, notamment celui sur NaissancE, Witness, et les Souls. Et aussi parce que c’est un des rares que je n’avais pas encore lu de Roland.
Bandes dessinées
A Silent Voice, série complète (Yoshitoki Ooima, 2014): à quel niveau de projection, de pensée magique et de déconnexion avec la réalité il faut être pour croire qu’il suffit de faire le chevalier blanc pour la personne dont on a ruiné l’enfance et la scolarité — via un harcèlement systématique basé sur un handicap — pour, non seulement avoir droit à un arc de rédemption, mais qu’en plus la personne en question carbure au syndrome de Stockholm, te pardonne et tombe amoureuse de son ancien bourreau ?!?!?! Quelle mauvaise plaisanterie. C’est du niveau de Ano Hana, par certains côtés. Urgh.
Le Sommet des Dieux, série complète (Baku Yumemakura, Jiro Taniguchi, 2003): une belle histoire, des paysages de montagne qui inspirent. Ça change de Céleste pour le côté “gravir la montagne et dépasser ses limites”, littéralement.
Olympe de Gouges (Bocquet, Catel, 2013): l’aspect graphique ne m’a fait ni chaud ni froid, mais j’étais plus intéressé par la leçon d’histoire et la biographie de cette femme.
Noragami, volume 1 à 6 (Adachitoka, 2010): j’ai abandonné en cours de route, ça ne va pas très loin, un shounen classique.
Arte, volume 2 (Ohkubo Kei, 2013): non, c’est toujours aussi nul.
Vinland Saga, volume 2 à 17 (Makoto Yukimura, 2005): la narration offre des surprises, c’est rafraîchissant.
Cadavre Exquis (Pénélope Bagieu, 2010): plutôt moche — on va dire quelconque plutôt, ça sera moins polarisant — et puis surtout ça ne parle de rien si ce n’est du nombril de parisiennes et parisiens. Comprenez que ça ne m’affecte guère. La fin est d’un ridicule sans nom.
S’enfuir, récit d’un otage (Guy Deslile, 2016): pas sûr de voir en quoi le medium de la bande dessinée amène quelque chose à cette histoire, si ce n’est peut-être le renforcement du sentiment de routine qui surgit après 20 pages où on voit le même dessin de cette même cellule avec la même palette de couleurs et les mêmes quatres arêtes. Mais bon.
L’orme du Caucase (Jiro Taniguchi, Ryuichiro Utsumi, 2004): niais.
Un ciel radieux (Jirô Taniguchi, 2006): niaiseux.
Polina (Bastien Vivès, 2011): il y a un peu de Black Swan là-dedans, dans la relation entre Polina et son maître de danse. Et sinon, un trait fugace mais grossier, épais, qui capture paradoxalement le mouvement du corps effilé, la tyrannie des pointes et des portés.
Billy Bat, série complète (Naoki Urasawa, Takashi Nagasaki, 2008): à un moment je me suis rendu compte qu’il me restait quelques volumes avant la fin, et je ne voyais pas cette fin, je n’arrivais pas à concevoir comment tout cela pouvait bien se terminer. C’était un sentiment très gênant, qui a terni mon appréciation relative de l’oeuvre. Et effectivement, je n’ai pas vu arriver la fin, parce qu’elle n’arrive pas. Ils auraient pu continuer encore quinze volumes comme ça, à enchaîner les évènements un peu polémiques de l’histoire, faire des liaisons en fil rouge tendu sur des photos épinglés sur un tableau en liège. Vers la moitié du récit, je n’étais plus dedans, c’était de l’automatisme. Il reste toutefois un commentaire sur le processus de création, un peu de méta sur le medium, et un sens du mystère — pour la première moitié.
Scott Pilgrim, volume 1 à 3 (Bryan Lee O’Malley, 2004): suite au nouveau visionnage du film j’ai replongé dans la lecture des premiers comics. Les différences entre les deux racontent des histoires différentes, mais complémentaires. L’accent est moins porté sur la culture jeux vidéo des années 80/90 aussi.
Ad Astra, volume 1 à 11 (Mihachi Kagano, 2011): tout comme Olympe, l’histoire m’intéresse plus que le style.

Musique
Desire (Mark Redito, 2019): cela aurait pu être la bande-son de Dustforce, dans une réalité alternative.
Elementary Particles (Bluetech, 2020)
Phantom Chains (Astropilot, 2020)
Rise & Fall (Douze, NewRetroWave Records, 2019)
Every Ending is a New Beginning (Marcos Ubeda, 2018): méditatif.
Phobos Monolith (Mare Cognitum, 2014)
Oxygène (Jean-Michel Jarre, 1976)
Emergence (Max Cooper, 2015)
A Vava Inouva (Idir, 1976): une douceur dans la voix.
Discovery (Daft Punk, 2001)
A Curious Tales + Persons (Little Simz, 2015): son phrasé et le rythme à laquelle elle le déclame est entraînant, hypnotique; les thèmes abordés font mouche.
Ella and Louis (Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, 1956)
Wolastoqiyik Lintuwakonawa (Jeremy Dutcher, 2018): la plus grande découverte de l’année, sans doute. Un travail d’archivage et de transmission de l’histoire des First Nations autrement plus intéressant que dans Never Alone.
No Place (A Lot Like Bird, 2013)
Sirens (Nicolas Jaar, 2016)
Psychic (Darkside, 2013)
Stillness in Wonderland (Little Simz, 2017)
Drop 6 (EP)(Little Simz, 2020)
Griseus (Aquilus, 2011)
Flow State (Tash Sultana, 2018)
Dummy (Portishead, 1994): ça chouine trop, c’est des morceaux pour continuer d’aller mal quand ça va mal, et ce n’est pas mon attitude quand je suis dans ces états. Plus vite j’en sors et mieux c’est, la réponse est donc souvent de la musique plus énergique, avec autre chose qu’un 4/4 en boîte à rythme neurasthénique derrière pour la batterie, et des notes moins étirées qu’un kilomètre de réglisse. Ce constat s’applique à d’autres albums dans cette liste.
Tryptych (Demdike Stare, 2011)
dombrance (Dombrance, 2005): découvert par hasard sur un morceau qui avait le nom d’un homme politique français, et j’ai écouté le reste pour voir. J’ai vu.
Crashes in Love (William Onyeabor, 1977)
Atomic Bomb (William Onyeabor, 1978)
Tomorrow (William Onyeabor, 1979): petit triplé sur Onyeabor, musicien nigérien oublié des années 70/80, découvert à l’origine sur un site qui propose d’écouter de la musique qui vient d’un peu plus loin que les Etats-Unis ou l’Angleterre, pour un peu décoloniser vos cerveaux ravagés: https://radiooooo.com/
The Mountain (Haken, 2013)
Compro (Skee Mask, 2018)
Just Another Diamond Day (Vashti Bunyan, 1970): à ne pas écouter trop souvent, ça finit par devenir du one-trick poney.
Some Things Just Stick In Your Mind (Vashti Bunyan, 2015)
Junun (Shye Ben Tzur, Jonny Greenwood, The Rajasthan Express, 2015)
GREY Area (Little Simz, 2019)
Mamani (Joy Denalane, 2002)
MANGOTALE (Shawn Wasabi, 2020): une soupe indigeste de collage numérique.
Person Pitch (Panda Bear, 2007)
The Sadness of Things (Steve Stapleton, David Tibet, 1991): album qui a inspiré Katalin Varga.
Bloodstone & Diamonds (Machine Head, 2014)
Catharsis (Machine Head, 2018): très gênant. La construction mélodique ne ressemble à rien, les riffs sont peu inspirés, la batterie se contente de faire du double tempo et des swiss triplets à tout-va, les paroles nous feraient regretter les lamentations angsty de Nirvana. Elle est loin l’époque de The Blackening où on parle de l’autoritarianisme des religions en place. Maintenant on parle du danger des drogues dures (c’est dangereux, vous voyez), et de la difficulté de vivre à Los Angeles. Bouhouh.
Pablo Honey (Radiohead, 1993)
The Bends (Radiohead, 1995)
OK Computer (Radiohead, 1997)